|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Forum] | [Contact e-mail] |
|
||||||

| Navigation | ||
 oOo
Une soutane dans les salons L’abbé Mugnier et son Journal (1879-1939) Benoît Pivert 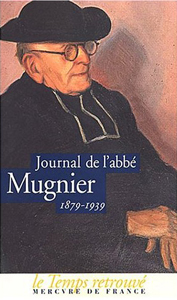
Si la curiosité est un vilain défaut, il faut bien admettre que la prose offerte par l’abbé Mugnier dans son journal[1] flatte ce qu’il y a de plus vil dans la nature humaine, à savoir le goût des ragots qui lui-même dissimule d’autres penchants tout aussi inavouables tels que la jalousie ou l’envie. Comme le lecteur des feuilles à scandale, ne se surprend-on pas, au fond, à attendre de celui que l’on surnomma le « confesseur des duchesses » quelque épicé secret d’alcôve ou la énième confirmation que l’argent ne fait pas le bonheur ? Il faut dire que l’abbé Mugnier s’entend à captiver le lecteur. Lorsqu’il vous apprend que Théophile Gautier terminait certaines épîtres à ses amis par la formule « Je te baise le cul avec componction », que Maupassant s’était vanté devant Huysmans de pouvoir épuiser une femme sous lui à force d’assauts et s’était exécuté sous l’œil goguenard de Flaubert, l’envie vous prend d’en savoir plus, pour peu que vous ayez un tant soit peu l’âme cancanière. L’indiscrétion a toujours un goût de revenez-y. L’intérêt du Journal de l’abbé Mugnier serait toutefois un peu mince s’il ne s’agissait là que de simples miscellanées de ragots glanés dans les salons mais le Mercure de France n’a, par chance, retenu que les pages présentant quelque intérêt pour la postérité ou permettant de comprendre les ressorts de la psychologie de l’auteur. On y découvre tout d’abord un abbé qui retient l’attention par un mélange détonant de snobisme et d’ouverture d’esprit. Nous pouvons dire sans déflorer notre sujet que l’abbé redore le blason de l’Eglise catholique durant l’affaire Dreyfus et la Grande guerre. Au-delà de sa personne, son journal permet, à travers une vie mondaine à donner le vertige conjointe à une exceptionnelle longévité, de suivre la vie de la République des lettres sur six décennies. On fut parfois féroce à l’endroit de l’abbé. Bloy pour qui Mugnier incarnait l’abomination d’un clergé salonnard l’exécuta à sa manière. Il le décrivit comme un vieux renard qui « retrousserait sa soutane pour entrer dans l’étable de Bethléem »[2], autrement dit un rusé qui aurait voulu être aux premières loges sans éclabousser son habit dans la fange de l’étable. L’image n’est pas fausse mais elle est réductrice comme nous nous proposons de le démontrer maintenant. A dire vrai, rien ne prédisposait socialement l’abbé à devenir un jour le confesseur des duchesses. Arthur Mugnier voit le jour en 1853 à Lubersac dans le Limousin où son père est chargé des travaux de restauration du château. A la mort de son père, la mère emmène avec elle l’enfant à Paris. Cette Lorraine fervente laisse entrevoir plus tard à l’adolescent les avantages de l’état ecclésiastique qui, hormis la quiétude qui l’accompagne, permet au simple mortel de s’attacher les confidences et l’amitié des âmes bien nées. Arthur est un enfant docile et rêveur qui n’oppose pas de résistance aux ambitions que sa mère nourrit pour lui d’autant que sa foi est sincère et confine au scrupule. Recommandé par le marquis de Lubersac, Arthur fait son entrée au séminaire de Nogent-le-Rotrou auquel succèdera le séminaire de Saint-Sulpice. Après son ordination par Monseigneur Guibert, Arthur Mugnier enseigne d’abord au Petit-Séminaire de Notre-Dame-des-Champs où il s’ennuie, lassé de « s’abêtir dans l’enseignement monotone des mêmes règles de grammaire »[3]. C’est là qu’il commence à tenir son journal qui deviendra son confident pendant soixante ans, jusqu’à ce que des problèmes de vue obligent l’abbé à poser la plume en 1939. Pendant toutes ces décennies, le journal va être le témoin de son ascension sociale, de ses revers aussi parfois. En 1879, Arthur Mugnier quitte le Petit-Séminaire pour être nommé vicaire à Saint-Nicolas des Champs, à deux pas des Halles, en plein négoce. En 1888, il devient vicaire de Saint-Thomas. De 1893 à 1896, il officie comme second vicaire à Notre-Dame des Champs. En 1896, l’abbé est nommé vicaire à Sainte-Clotilde qu’il compare à une catacombe. En 1910, l’archevêque de Paris le nomme aumônier auprès des religieuses de Saint-Joseph-de-Cluny. Il finira Chanoine honoraire de Paris à partir de 1924 avant de mourir en 1944, âgé de quatre-vingt-onze ans.
Pendant toutes ces années, le journal va recueillir les états d’âme de l’abbé, les moments d’enthousiasme et d’abattement d’un homme qui voudrait vivre de la vie de l’esprit, qui s’étiole donc dans l’obscurité des sacristies et revit au contact des artistes. Même si la foi de l’abbé ne paraît jamais ébranlée, l’homme n’est pas toujours heureux des situations qui lui sont faites. Sainte-Clotilde est trop sombre, Saint-Nicolas-des-Champs trop populeux, « trop de boutiques, trop de peuple, trop de cris, trop de voitures, trop de marchands, trop d’appels incessants et vulgaires ! »[4]. L’abbé confie donc au journal son amertume, son découragement devant l’étroitesse d’esprit des dévotes ou l’intolérance de sa hiérarchie mais l’homme ne sombre jamais durablement dans la mélancolie, happé qu’il est par le tourbillon du monde. Un souper fin suffit à le réconcilier avec la vie. Et puis, il a pour le consoler ces écrivains à qui l’unissent des affinités électives, Chateaubriand qu’il cite volontiers, Goethe et Schiller qui lui ont donné le goût de l’Allemagne. Il y a encore le spectacle de la politique qui ne laisse jamais indifférent le prêtre pendant toutes ces années où le renouveau du catholicisme se heurte à un anticléricalisme belliqueux et que la paix en Europe est si souvent menacée par la folie sanguinaire des hommes. Le journal offre donc jour après jour une multitude d’observations, d’impressions et de réflexions qui ne suscitent jamais l’ennui.
Il faut bien admettre que l’abbé peut agacer tant est grand son désir de voir et d’être vu. Cette soif de reconnaissance l’habite dès le séminaire, « ma vocation était d’être professeur, mais à la condition qu’on parlât de moi. J’ai faim et soif de la sympathie d’autrui. Au fond, la gloire, toujours la gloire ! »[5]. Il souffre donc plus tard de porter trop souvent le triste habit noir de vicaire auquel il préfère « le cortège brodé et doré des aubes et des chasubles (…), les pompes divinement bruyantes. »[6] Il aimerait être de toutes les fêtes, de toutes les tablées et s’afflige lorsqu’il n’est pas convié au banquet des Goncourt. En revanche, il exulte lorsque toute la presse, depuis Le Figaro jusqu’au Gil-Blas, parle de sa conférence du 19 mars 1895 sur Huysmans. Sa sensibilité littéraire et ses qualités d’orateur sont enfin reconnues. L’abbé a bien conscience parfois de la vanité d’une existence faite de mondanités – « Ah ! Le vide de ma vie ! J’ai beau […] courir, à travers le Faubourg-Saint-Germain, de salle à manger en salle à manger, tout cela me laisse l’âme trouée, ravinée, incertaine et morte »[7] - mais ce ne sont là que d’occasionnels éclairs de lucidité. Les séductions du monde sont par trop aveuglantes. Il n’ignore pas non plus le décalage criant entre son goût du luxe et l’exemple de simplicité évangélique livré par le Christ – « les pauvres que le Christ évangélisait et dont il faisait ses apôtres ne recevaient ni lièvres ni perdreaux »[8] – pour autant, cela ne le retient de manger ni le lièvre ni les perdreaux. La mauvaise conscience chez l’abbé Mugnier est toujours très fugace. Un bon vin suffit à la dissiper. Il faut toutefois reconnaître à l’abbé le sens de l’autodérision lorsqu’il avoue : « je suis le prêtre des Noces de Cana. Je ne suis pas celui du jeûne au désert »[9]. Il semble que, l’âge aidant, l’abbé ait toutefois perdu quelques illusions sur le monde qui depuis toujours l’avait fasciné. Une visite au marquis de Lévis lui inspire ce regret : « Que cette aristocratie est peu cultivée et d’une conversation restreinte »[10]. A cinquante ans passés, il emprunte même ses accents à Rousseau : « Pour moi, le grand mal c’est de vivre en société. On ne peut pas être soi, au milieu des hommes. »[11] Ce qui se dessine, en effet, paradoxalement derrière le tourbillon des réceptions, c’est une grande solitude. L’abbé est condamné par les conventions à jouer son rôle d’ecclésiastique sans jamais pouvoir s’épancher. Il est l’éternel confesseur, celui qui ne fait jamais que recueillir la parole d’autrui. S’il s’avisait de faire connaître son point de vue sur le peu de charité chrétienne de ces catholiques qui portent leur foi comme un ostensoir, il ne pourrait que choquer, décevoir, s’aliéner des sympathies… et perdre des invitations. Il se résout donc aux compromissions qu’exige la vie d’un abbé mondain, à savoir « atténuer, éteindre, dissimuler, corriger toutes choses »[12]. Ne pouvant jamais être lui-même, il se laisse aller à ce cri du cœur : « je crève de solitude morale »[13]. Son journal n’en a que plus de prix. Il est le lieu où le masque tombe, où l’abbé s’autorise des emportements mais on est bien loin des fureurs d’un Léon Bloy. Il suffirait de peu parfois pour que l’abbé ne devînt misanthrope. Ce qui lui manque, c’est le courage. L’abbé Mugnier n’a pas l’étoffe d’un « mendiant ingrat »[14].
Bien que son journal ne fût pas destiné à la publication et que l’abbé n’ait donc pas à tenter de se justifier devant de quelconques lecteurs, il tient à préciser vers la fin – peut-être pour se justifier devant sa propre conscience – que, si son journal relate surtout ses dîners et ses rencontres, il n’en a pas moins été un prêtre zélé dans l’accomplissement des devoirs de sa charge. On ne demande qu’à le croire, pourtant quelques doutes semblent permis quant à l’ardeur du prêtre et ces doutes ne manqueront pas d’agacer les catholiques les plus sourcilleux. Quand il n’y a qu’à verser de l’eau et administrer l’extrême-onction, tout va bien mais très vite le mondain se fatigue : « Quand il faut consoler un malade, exhorter un mourant, diriger une conscience, c’est la série des travaux d’Hercule »[15]. Qu’on ne lui demande pas non plus de suivre les foules dans les pèlerinages ! Il n’épargne pas ses sarcasmes à « ces pauvres évêques qui ne savent que prendre le chemin de Lourdes, de Paray-le-Monial ou du Sacré-Cœur de Montmartre ! C’est du faux Moyen Âge. L’abus de la prière ! »[16] On frôle le blasphème… De même qu’il est conscient de son goût immodéré pour les mondanités, l’abbé n’ignore pas ses limites en matière de spiritualité. Le 7 octobre 1884, il conclut son séjour à la Trappe par ces mots : « Non, je ne me ferai pas trappiste, c’est trop dur »[17]. La prédication le lasse, la direction de conscience le fatigue, les confessions sans surprises dans lesquelles on s’accuse de peccadilles l’ennuie : « Comme je dis intérieurement à ces jeunes filles, à toute notre clientèle : partez, partez ! Assez de péchés entendus, de ciboires vidés, de saluts donnés, de sermons, d’oraisons, de direction, que sais-je ! »[18] Sans être dévot, on ne peut manquer de s’étonner du choix des mots. Clientèle semble supposer une relation bien étrangère à la foi. Et qu’est-ce que cette incapacité à supporter la vue du troupeau des fidèles ? Ne serait-ce pas là une forme d’acédie, terme par lequel on désignait depuis Evagre le Pontique (IVème siècle) et Jean Cassien (Vème siècle) le dégoût des choses de la foi, la torpeur spirituelle qui s’emparait des moines ? Curieusement, bien que l’acédie figure depuis le Moyen Âge dans la liste des péchés capitaux, l’abbé n’en éprouve aucune mauvaise conscience. Il s’accommode de ses faiblesses comme il accepte les faiblesses de ses pénitentes… tant que ces dernières ne viennent pas troubler sa quiétude par des scrupules excessifs. Il ne fait pas de doute que pour un chrétien comme Léon Bloy, l’abbé Mugnier est un homme de peu de foi. Mais curieusement, même si un abîme semble séparer le prêtre mondain du catholique enragé, lorsque dans son journal l’abbé s’autorise à être lui-même, le lecteur a l’agréable surprise de constater une liberté de ton rafraîchissante, voire un anticonformisme que n’eussent sans doute jamais soupçonné ceux qui l’invitaient à leur table.
Aussi surprenant que ceci puisse paraître, l’abbé porte sur le clergé et l’Eglise de son temps un regard sans aménité qui rejoint souvent celui de Léon Bloy. Tous les deux s’emportent contre cet esprit obtus qui fait confondre la beauté et le péché, comme si n’étaient chrétiennes que l’austérité, la grisaille et l’insipidité. Outré, l’abbé cite l’exemple qu’on lui a rapporté d’une religieuse couvrant la Vénus de Milo d’une chemise ! Il regrette qu’au séminaire on ne lui ait appris à célébrer ni la nature ni la vie comme des créations divines mais qu’on ait préféré brider son imagination par des pudeurs de vierges effarouchées. L’abbé est un sensuel qui aime le bon vin, la grâce des visages, les mets délicats, la nature luxuriante et qui abhorre cet esprit puritain qui voudrait que ce fût Carême trois-cent-soixante-cinq jours par an. Il déplore que l’Eglise ne patronne plus comme autrefois les arts et les lettres devenus suspects d’impiété. Lui n’hésite pas à délaisser un office pour assister à l’inauguration d’un monument à Corot et se plaint de ce que l’on voie d’un mauvais œil les prêtres dans les théâtres. Contrairement à Bloy qui n’irait pas si loin, il en vient à la conclusion que l’intelligence est dans le camp des républicains. Il aimerait donc que l’Eglise se concilie leurs talents au lieu de jeter sur eux l’anathème : « Oh ! Je suis plus que jamais désolé de l’incroyable rupture qui s’est faite entre les républicains intelligents et nous. Pourquoi n’avons-nous pas tenté de nous rapprocher de ces hommes si admirablement doués ? »[19] Plus généralement, c’est le traitement réservé aux incroyants que l’abbé Mugnier condamne : « Notre tort, à nous catholiques français, à nous prêtres, c’est de considérer les incroyants comme des ennemis qu’il faut écraser, morfondre et non pas convaincre, persuader et convertir. »[20] Mais l’abbé sait que l’Eglise de son temps préfère garder ses œillères et ce n’est pas là le seul de ses griefs à l’endroit des hommes et de l’institution. Son tableau de l’état de l’Eglise est accablant : « l’égoïsme, l’avarice, l’accaparement des âmes, la légèreté, le succès injustifié, la bêtise des dévots, la vulgarité décorée, voilà ce que je vois ici. »[21] Il n’est pas plus tendre avec les hommes d’Eglise qu’avec leurs fidèles : « Et je ne dis rien du confessionnal, sorte de terrier où la curiosité, l’indiscrétion, le verbiage, la niaiserie se disputent les consciences de quelques femmes hystériques, scrupuleuses, bavardes, désœuvrées, le dessous du panier. »[22] Parce qu’il ne tient pas le clergé en haute estime, l’abbé va même, au plus fort de la politique anticléricale, à se réjouir de l’expulsion des dignitaires de l’Eglise hors de leur palais, impatient qu’il est de voir s’ils brilleront par leurs qualités d’âme, une fois privés de leurs plafonds dorés. Et lorsqu’en 1904, Combes fait fermer tous les établissements religieux, l’abbé a la hardiesse de s’interroger : « Mais ce monde avait-il vraiment été fécond ? »[23] C’est principalement par sa tolérance que l’abbé Mugnier se distingue des catholiques de son temps. Dans le climat de haine antidreyfusarde, l’abbé prend les allégations colportées sur le capitaine Dreyfus au conditionnel et ce conditionnel l’honore. Lors du procès de 1899, il se déclare même pour l’acquittement. L’antisémitisme chrétien l’afflige : « Cette haine des juifs est vraiment insensée ! Les femmes s’exaltent contre eux. Des femmes qui se disent chrétiennes. Quelle misère ! »[24]. Son jugement sur l’agitateur antisémite Edouard Drumont est sans appel : « la pire canaille de ces dernières années »[25]. L’abbé refuse, de même, de crier haro sur les francs-maçons. Quand ses commensaux, Huysmans et Léon Daudet, évoquent les complots voire les crimes de la franc-maçonnerie, il note sobrement « ce en quoi je ne les suis pas »[26]. L’amour du prochain pris au pied de la lettre se manifeste encore à l’encontre de l’ennemi héréditaire allemand. Tandis que Léon Daudet demande que « les Français le saignent sans merci sur leur billot »[27], l’abbé fait la morale à ses coreligionnaires dont la dureté de cœur l’effraie : « On est si sévère contre l’homicide – non occides ! Et puis, on trouve tout naturel de tuer des milliers de personnes ! Oui, mais c’est pour une cause juste. Il n’y a pas une cause assez juste pour valoir tant de sang répandu »[28]. Ce pacifisme inconditionnel montre chez l’abbé une grande liberté par rapport à l’esprit du temps. C’est ce même anticonformisme qui lui inspire des positions très avant-gardistes par rapport à la messe, à la première communion, à l’eucharistie ou à la sexualité. L’abbé s’insurge ainsi, longtemps avant Vatican II, contre l’usage du latin pendant les offices qui, à ses yeux, éloigne les fidèles. Selon lui, si l’Eglise est une mère, elle doit parler le langage de ses enfants. Tout comme il désapprouve l’usage du latin, il critique la décision de Pie X d’instaurer en 1910 la première communion à sept ans, c’est-à-dire à un âge où les enfants ne peuvent choisir en connaissance de cause. L’abbé n’est pas non plus pour cette mode qui consiste à recevoir le corps du Christ, la langue tirée. Il souscrit à la répulsion de son confrère, l’abbé Brémond, pour qui par là même « on enivre le prêtre de laideurs »[29]. Cette fois, l’abbé est pour le retour à la simplicité évangélique du pain rompu dans la main. Anticonformiste, l’abbé l’est encore lorsqu’à la différence de l’Eglise, il admet en 1916 – avant de connaître Freud qu’il ne découvre qu’en 1917 – la puissance des pulsions : « Je crois que l’instinct sexuel est l’explication de tout, puisque tout en vient. La psychologie doit sortir de là, de cette double étreinte. »[30] Il va jusqu’à prôner l’éducation sexuelle et déplore que, sur cette question, l’Eglise soit retenue par des pudeurs de vieille fille. Freudien avant l’heure, l’abbé a compris le mécanisme de la sublimation : « Mes vœux m’ayant interdit la femme, tout mon cœur a passé dans mes livres. L’enthousiasme n’est au fond qu’une déviation, qu’un déguisement de volupté. »[31] Il n’y a guère que dans le domaine de l’homosexualité qu’il faille apporter un bémol. On mesure, en effet, au choix de certains mots la répulsion qu’inspirent à l’abbé les sodomistes, ainsi dans ce portrait de Jean Lorrain : « Lorrain est toujours fleuri de gardénias, couvert de bagues et puant de parfumerie, avec des ongles peints. »[32] A propos des opérations chirurgicales que doit subir Lorrain, il est question du « résultat de ces vices »[33], ailleurs de « cette sorte de luxure »[34]. Pour l’abbé, tout cela sent la décadence, le recul des valeurs chrétiennes. Lorsqu’il apprend que Lorrain déclare que « la femme sent mauvais »[35] et qu’il préfère l’homme qui sent « le pain chaud »[36], l’abbé s’insurge « Sommes-nous assez revenu au paganisme ? »[37]. Le voici, une fois n’est pas coutume, conservateur. Force est d’avouer qu’en matière d’homosexualité, celui qui s’est affranchi de bien des idées reçues demeure prisonnier des préjugés de son siècle. Ailleurs, il connaît peu d’interdits. Bravant la condamnation qui pèse sur le spiritisme, par faiblesse aussi – pour complaire à ses amies – il s’adonne le 30 janvier 1908 à une expérience de tables tournantes. Il ne se contente pas d’être le spectateur, il participe à la chaîne autour de la table aux côtés d’Anatole France. La présence d’un prêtre ne semble pas avoir mis les esprits en fuite puisque la table se serait soulevée et serait retombée à terre avec bruit. Lorsqu’il est seul avec lui-même l’abbé ne redoute pas non plus de s’aventurer sur des sentiers théologiquement glissants. Faisant fi du passage de l’Evangile de Saint-Mathieu sur l’efficacité de la prière, il se gausse de la naïveté des catholiques qui ont cru pouvoir infléchir le résultat des élections et empêcher en mars 1906 la victoire des socialistes anticléricaux en implorant le ciel : « Et les dévots qui croyaient qu’avec des communions et des chemins de croix on transformait le suffrage universel »[38]. Pourtant, au regard de la foi, la position de l’abbé Mugnier n’est guère défendable. Ce dernier prend des risques encore en s’attaquant à la dévotion au Sacré-Cœur. Manifestement, la vue d’un cœur qui saigne incommode la sensibilité délicate de l’abbé : « Le Sacré-Cœur ! Ce cœur rouge retiré du corps humain. Une dévotion faite pour un siècle d’opérations, pour une époque de chirurgiens ! »[39] Bien que l’abbé ne traverse pas de crise spirituelle durable, la Grande guerre semble l’ébranler et susciter en lui des interrogations métaphysiques profondes en le confrontant au mystère de la coexistence d’un Dieu bon et de la souffrance humaine. Celui qui déclare : « tout me fatigue hormis l’exercice de ma liberté »[40] revendique le droit de s’interroger sur le scandale du mal sans souscrire par avance aux réponses toutes faites de la religion : « Ce Dieu dans une hostie, en permanence, sur les autels et qui laisse s’égorger ses enfants ! On nous plonge dans le mystère, on ne nous dit rien, on nous oblige à deviner, on nous met aux prises avec une nature diamétralement opposée aux lois écrites, et si nous doutons un instant, si nous confessons que l’obscurité est trop grande, nous voilà condamnés éternellement aux flammes de l’au-delà. »[41] Il est courageux pour un prêtre d’admettre le doute, ne serait-ce que le doute d’un instant. L’abbé ne dissimule pas ses états d’âme, même lorsqu’ils semblent si sombres qu’on pourrait aisément les prendre pour ceux d’un athée tant l’espoir semble absent, ainsi dans ce passage où l’abbé remonte les Champs-Elysées jusqu’à l’Arc de Triomphe en 1919 en se souvenant des victimes de la guerre : « Ceux qui sont morts sont morts. Il n’y a pas de Lazare qui ressuscite avec son casque de Lazare bleu horizon et poilu »[42]. Ne croirait-on pas entendre ici la résignation d’un homme sans Dieu ? L’abbé a parfois payé le prix de son anticonformisme. Refusant de hurler avec les loups, il avait reçu à sa table Charles Loyson dit le Père Hyacinthe, célèbre prédicateur ayant rompu avec l’Eglise à la suite d’une querelle sur l’infaillibilité pontificale. Pis, l’abbé l’avait invité avec sa femme ! Mal lui en prit. Il fut immédiatement convoqué par Mgr Amette qui, non content de le sermonner, lui retira son poste de premier vicaire à Sainte-Clotilde et le nomma d’office aumônier des sœurs de Saint-Joseph-de-Cluny. On comprend mieux les réflexes de prudence de l’abbé dans le monde en se souvenant de l’étroitesse d’esprit de l’Eglise qui lui inspire ces regrets : « Si l’état de mes yeux me permettait d’écrire, sans crainte, j’en serais empêché par la perspective de l’Imprimatur. Je ne puis pas écrire ce que je pense, ce que je sens parce que je suis un émigré de l’intérieur. Mais le serais-je, à un moindre degré, toute publication me serait interdite, car mon genre étonnerait, choquerait. »[43] On ne peut toutefois s’empêcher de regretter que l’abbé n’ait pas eu précisément le courage d’étonner et de choquer pour ébranler les consciences de ses contemporains, préférant comme le serviteur de l’Evangile enfouir ses talents par peur de la sévérité du maître.
Si le journal séduit par l’originalité des idées de l’abbé qui trouvent à s’exprimer sans crainte de la censure, il charme aussi le lecteur par le tableau vivant qu’il offre de la République des lettres depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à l’aube de la Seconde guerre mondiale. Ce n’est pas un hasard si le 1er février 1893, l’abbé donne une conférence sur les salons de la Restauration car celui qui aime « les noms, les belles demeures, la réunion des beaux esprits, le contact des célébrités »[44] est, dans l’âme, un homme de salon. Il s’épanouit dans les appartements de la poétesse Anna de Noailles, entouré de tout ce que Paris compte de beaux esprits. Il a le goût des cabrioles intellectuelles, des mots d’esprit, des saillies qui font mouche, de ce mélange subtil de profondeur et de légèreté et, comme il est observateur, le lecteur voit se dessiner sous sa plume le portrait du Tout-Paris intellectuel et mondain. Si par l’esprit il appartient au XVIIIe, par la technique, il se rapproche des peintres impressionnistes. Il procède par petites touches qui finissent par former un tout. Il serait faux de dire que l’abbé est un portraitiste brillant. Il a tendance à ne pas peindre ses modèles d’après nature mais d’après reproduction, en rapportant les traits saillants des confidences qu’on lui fait. Cela donne toutefois des portraits dignes d’intérêt comme ce portrait exceptionnel de sensibilité de la poétesse Renée Vivien réalisé d’après les confidences d’un officier colonial, M. Drouin : « Drouin m’a dit et répété qu’il n’avait pas connu de nature plus élevée que celle de René Vivien et en même temps plus éclaboussée de boue. Elle avait le dégoût d’elle. Elle essaya de se suicider, de se laver dans la mort »[45]. Quand toutefois l’abbé fait le portrait de ses intimes, il peint d’après nature. Cela nous vaut des portraits souvent étonnants dans lesquels la lumière tombe soudain sur des aspects habituellement dans l’ombre. On découvre ainsi un Barrès moins héroïque que ne le laisserait soupçonner sa littérature. Barrès le fier est le fils d’un hypocondriaque et s’intitule lui-même « le morne ». Lui qu’on croirait si maître de soi apparaît victime d’une folle passion pour Anna de Noailles. Le portrait n’est pas à l’honneur du grand homme. Misanthrope, cynique, sadique, on l’entend dire à l’objet de sa flamme : « Je voudrais vous voir malade et morte »[46]. A l’aise dans les portraits en demi-teintes, l’abbé montre la complexité d’un personnage comme Robert de Montesquiou dont la postérité a gardé le souvenir d’un mondain décadent. Derrière la façade du causeur mondain content de soi qui dilacère tout un chacun, l’abbé dévoile un être sensible qui a profondément aimé son secrétaire particulier argentin et qui a été ravagé par sa perte. L’abbé a l’art de saisir l’âme de ses interlocuteurs. Son portrait de Bloy est bref mais va à l’essentiel : « Il ne croit pas aux douleurs des riches. Pour Bloy, il n’y a qu’une douleur, c’est de manquer d’argent »[47]. De temps en temps, l’abbé se fait plaisir en choisissant des sujets hauts en couleur comme le Sâr Péladan : « Le Sâr, très aimable avec sa Forêt-Noire sur la tête ! Et quels yeux ! Evidemment une figure de névrosé ! »[48] L’abbé se délecte des élucubrations de Joséphin Péladan qui veut réunir les quatre Evangiles en un seul. Mais l’abbé a une telle capacité d’écoute, de bienveillance que même les êtres les plus irrationnels se sentent compris. Le Sâr est tellement conquis qu’il demande à l’abbé de concélébrer son mariage. Cruel dilemme, l’abbé ne pouvant se résoudre à devenir la risée du Tout-Paris… En raison de son extraordinaire longévité, l’abbé Mugnier a vu finir bien des carrières – Hugo, Anatole France, Barrès – mais il en a vu aussi débuter beaucoup d’autres, songeons à Mauriac ou Cocteau. Le statut de confesseur ou de confident lui a permis d’avoir accès à ces territoires les plus intimes de l’être qui demeurent inconnus du public. C’est ainsi que le lecteur découvre Cocteau à vingt ans, tenté par Dieu et amoureux d’une jeune fille que la mort lui a ravi. De tous les écrivains, celui que l’abbé Mugnier a le mieux connu et auquel il a consacré plusieurs conférences, c’est Huysmans dont il fut l’intime. Le lecteur suit l’amitié de l’abbé pour Huysmans depuis leur première rencontre le 28 mai 1891 lorsque le romancier vient exposer à l’abbé sa volonté de changer de vie en commençant par une retraite à la Chartreuse. L’abbé ne le quittera plus et l’accompagnera jusqu’à son lit de mort. C’est lui qui obtient pour Huysmans l’autorisation de faire une retraite décisive à la Trappe d’Igny. L’abbé analyse finement son ami : « Huysmans a la chair triste, à la différence de Zola qui a la chair gaie »[49]. Le portrait de Huysmans qui se dessine sous la plume de l’abbé est celui d’un misogyne, tiraillé entre la chair et les aspirations spirituelles, un brin crédule face aux occultistes illuminés qui l’entourent, attiré par le silence des cloîtres mais rebuté par la bêtise des prêtres. L’amitié de l’abbé pour Huysmans ne l’empêche pas d’avoir une certaine lucidité sur les limites de la conversation et de la prose de l’écrivain : « son génie du christianisme se réduit à peu de chose. »[50] De temps en temps, on aimerait que l’abbé Mugnier prenne le temps de s’installer devant son chevalet et peigne longuement, avec force détails, le portrait d’un écrivain qui dans le Journal tiendrait en une ou deux pages. Mais sans doute cela est-il par trop contraire à son intelligence qui caracole, passe d’un sujet à un autre, jette quelques coups de pinceau puis abandonne la toile avant de rajouter ici une note de couleur, là un clair-obscur, laissant les portraits prendre forme peu à peu au fil du temps et des pages.
« Recueillir des mots, noter des rencontres, être un parasite des vivants et des morts, puis cultiver des regrets de toute sorte »[51] ; l’abbé Mugnier n’est pas seulement le peintre des littérateurs de son temps, c’est aussi un observateur avisé de la nature humaine qui, dans son journal, fait œuvre de moraliste. Il y a quelque chose de Chamfort et de la Rochefoucauld dans cet abbé qui, assis aux meilleures tables, a passé son temps à scruter le cœur de ses contemporains. Il en tire des conclusions qui ne sont pas toujours à l’avantage de ses congénères : « les hommes s’occupe plus de gouverner leur pays que de se gouverner eux-mêmes. Nous sommes plus patriotes que moraux »[52]. L’état ecclésiastique lui confère une acuité de jugement dans l’analyse des rapports que les hommes entretiennent avec la foi : « l’homme garde, à travers la vie, la conception enfantine qu’on lui a donnée de la religion. Il s’est virilisé et la religion est restée au même point. »[53] Bien sûr, son terrain d’observation privilégiée reste la bonne société dont il entrevoit aussi les points faibles : « Un aristocrate n’aura jamais un vrai et original talent d’écrivain. Il y a trop de domestiques entre lui et la réalité. »[54] Certes, toutes les observations de l’abbé n’ont pas cette hauteur de vue. Bien souvent, il se contente de colporter des ragots. On apprend tour à tour que Zola a engrossé une servante, que, mort, Lamennais avait le corps d’un enfant mais un phallus disproportionné, que Suarès traitait Anna de Noailles de « poissarde » et que Renan couchait avec sa sœur. Cela n’est pas propre à changer la face du monde mais contribue à faire le charme du journal car après tout les détails scabreux font aussi partie de la vie. Ce qui ne laisse pas de surprendre le lecteur, en revanche, c’est la discordance entre la lucidité du moraliste et son goût du paraître et des belles images même si, comme nous l’avons déjà signalé, l’abbé semble avoir perdu avec l’âge quelques illusions sur la bonne société. Il est pourtant des passages qui semblent indiquer que l’abbé avait – heureusement – conscience qu’au-delà des limites du faubourg Saint-Germain il existait une humanité souffrante. On le voit sincèrement révolté après le suicide collectif d’une famille populaire de la rue d’Avron : « Toute une famille se suicidant pour échapper à la misère et cela d’un consentement unanime. Politiques et théologiens, que faites-vous donc ? Remplacez par l’action positive le verbiage de vos discours et de vos livres. Tant que la société sera aussi mal organisée, Rousseau aura prise sur moi. »[55] Pendant la Première guerre mondiale, alors que les aristocrates condescendent à serrer la main des domestiques qui ont servi au front tout en s’empressant d’ajouter que, la guerre finie, ils ne les inviteront tout de même pas à leur table, l’abbé est scandalisé par la morgue de cette caste qui se dit catholique : « Voilà le fond de la nature humaine et aristocratique et royale : maintenir les distances, les rangs, les supériorités et les infériorités. Est-ce vraiment chrétien ? »[56]. Cela suffit-il pour pardonner à l’abbé ses compromissions dans le monde, ses ronds-de-jambe devant les puissants et sa trahison de l’idéal de simplicité évangélique ? On serait tenté de dire non mais que celui qui n’a jamais péché lui lance la première pierre !
[1] Journal de l’abbé Mugnier, Paris, Mercure de France, 1985. [2] Ibid. p. 177. [3] Journal de l’Abbé Mugnier, p. 27 [4] Ibid. p. 30 [5] Ibid. p. 86 [6] Ibid. p. 32 [7] Ibid. p. 118 [8] Ibid. p. 121 [9] Ibid. p. 131 [10] Ibid. p. 190 [11] Ibid. p. 292 [12] Ibid. p. 124 [13] Ibid. [14] Léon Bloy, Le mendiant ingrat, Paris, Mercure de France, 1898 [15] Journal de l’abbé Mugnier, p. 30 [16] Ibid. p. 129. [17] Ibid. p. 47 [18] Journal de l’abbé Mugnier, p. 168 [19] Ibid. p. 33. [20] Ibid. p. 53 [21] Ibid. p. 57 [22] Ibid. [23] Ibid. p. 148 [24] Ibid. p. 115 [25] Ibid. p. 116 [26] Ibid. p. 149 [27] Ibid. p. 267 [28] Ibid. p. 266. [29] Ibid. p. 286 [30] Ibid. p. 297 [31] Ibid. p. 84 [32] Ibid. p. 97 [33] Ibid. [34] Ibid. p. 106 [35] Ibid. p. 105 [36] Ibid. [37] Ibid. [38] Ibid. p. 157 [39] Ibid. p. 291 [40] Ibid. p. 130 [41] Ibid. p. 306 [42] Ibid. p. 360 [43] Ibid. p. 189 [44] Ibid. p. 106 [45] Ibid. p. 247 [46] Ibid. p. 210 [47] Ibid. p. 146 [48] Ibid. p. 72 [49] Ibid. p. 79 [50] Ibid. p. 121 [51] Ibid. p. 375 [52] Ibid. p. 100 [53] Ibid. p. 137 [54] Ibid. p. 153 [55] Ibid. p. 56 [56] Ibid. p. 315 |
|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Contact e-mail] |